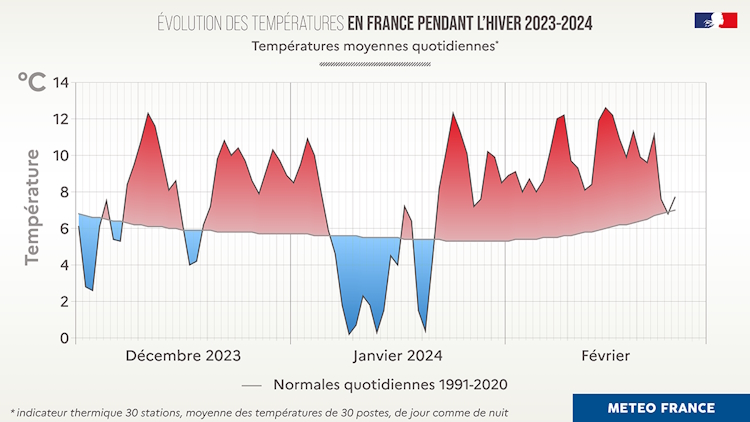Le 21 novembre 2024, Les Echos annoncent que le changement climatique aurait coûté à l’économie française environ 94 milliards d’euros en 2023. Cette estimation spectaculaire est issue des nouveaux « comptes nationaux augmentés » présentés par l’INSEE, qui cherche ainsi à intégrer le coût du réchauffement climatique dans les statistiques officielles.
Selon ces nouvelles mesures, l’empreinte carbone d’un pays englobe désormais non seulement ses propres émissions mais aussi celles des produits importés de pays à forte dépendance au charbon. L’INSEE considère ainsi que les t-shirts et appareils électroniques fabriqués en Chine contribuent directement aux émissions françaises, ce qui inverse la perception du rôle des grands consommateurs occidentaux dans l’échelle mondiale de la pollution.
De plus, le concept de PINA (Produit Intérieur Net Augmenté) a été introduit pour évaluer les coûts indirects liés aux effets du réchauffement climatique et à la transition vers une économie décarbonée. Cette approche novatrice suggère que sans ces contraintes environnementales, l’économie française aurait été plus performante en 2023.
Cependant, cette méthodologie pose de sérieuses questions sur la validité des chiffres fournis. Il est particulièrement difficile d’estimer avec précision le coût réel du « dérèglement climatique » et la transition énergétique. En réalité, ce sont les politiques mises en place pour atteindre un objectif de neutralité carbone qui entraînent ces coûts considérables.
En définitive, cette nouvelle approche statistique semble davantage orientée vers l’objectif politique d’accuser les pays développés plutôt que de fournir une évaluation objective des impacts environnementaux.