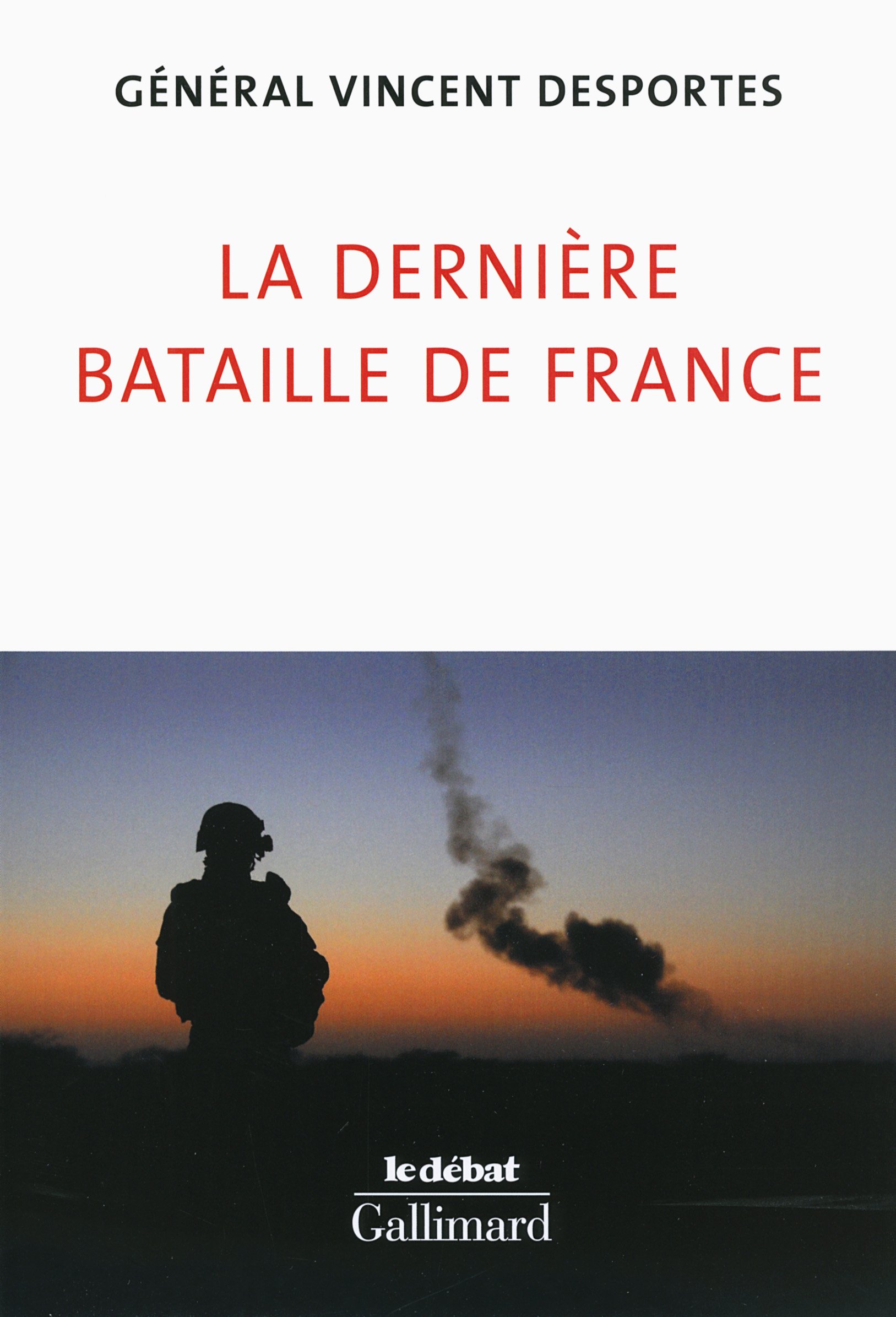Depuis le milieu du vingtième siècle, une sombre ombre plane sur les actions de l’État français en matière d’intervention pour libérer des citoyens emprisonnés à l’étranger. Les chiffres sont accablants : entre 1954 et la fin de 1962, plus de deux mille ressortissants français ont disparu en Algérie. Parmi eux figuraient 1643 civils et 380 militaires, parfois des mineurs ou des jeunes appelés.
Pendant cette période conflictuelle, divers rapports faisaient état de l’existence de camps secrets où étaient détenus ces otages dans des conditions horribles. Pourtant, les autorités françaises ont semblé peu enclines à agir activement pour leur libération ou même simplement identifier leur sort. C’est ainsi qu’une mission parlementaire envoyée en Algérie au printemps 1964 fut informée de l’isolement des prisonniers et ne put obtenir aucune réponse concrète.
Le ton était donné : malgré la gravité de la situation, les gouvernements successifs ont ignoré le sort des otages. Même après des années de silence, en 1971, Jacques Chirac, alors Premier ministre, niait catégoriquement l’existence d’un quelconque otage encore vivant.
Cette politique inerte a laissé un goût amer dans la bouche des familles concernées et une question persiste : est-ce vraiment ce que nous attendons de notre nation ?
La France se targue souvent de ne jamais abandonner ses citoyens, mais ces faits historiques mettent cette affirmation en doute.