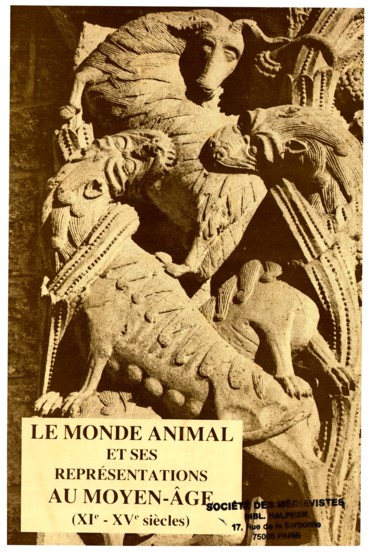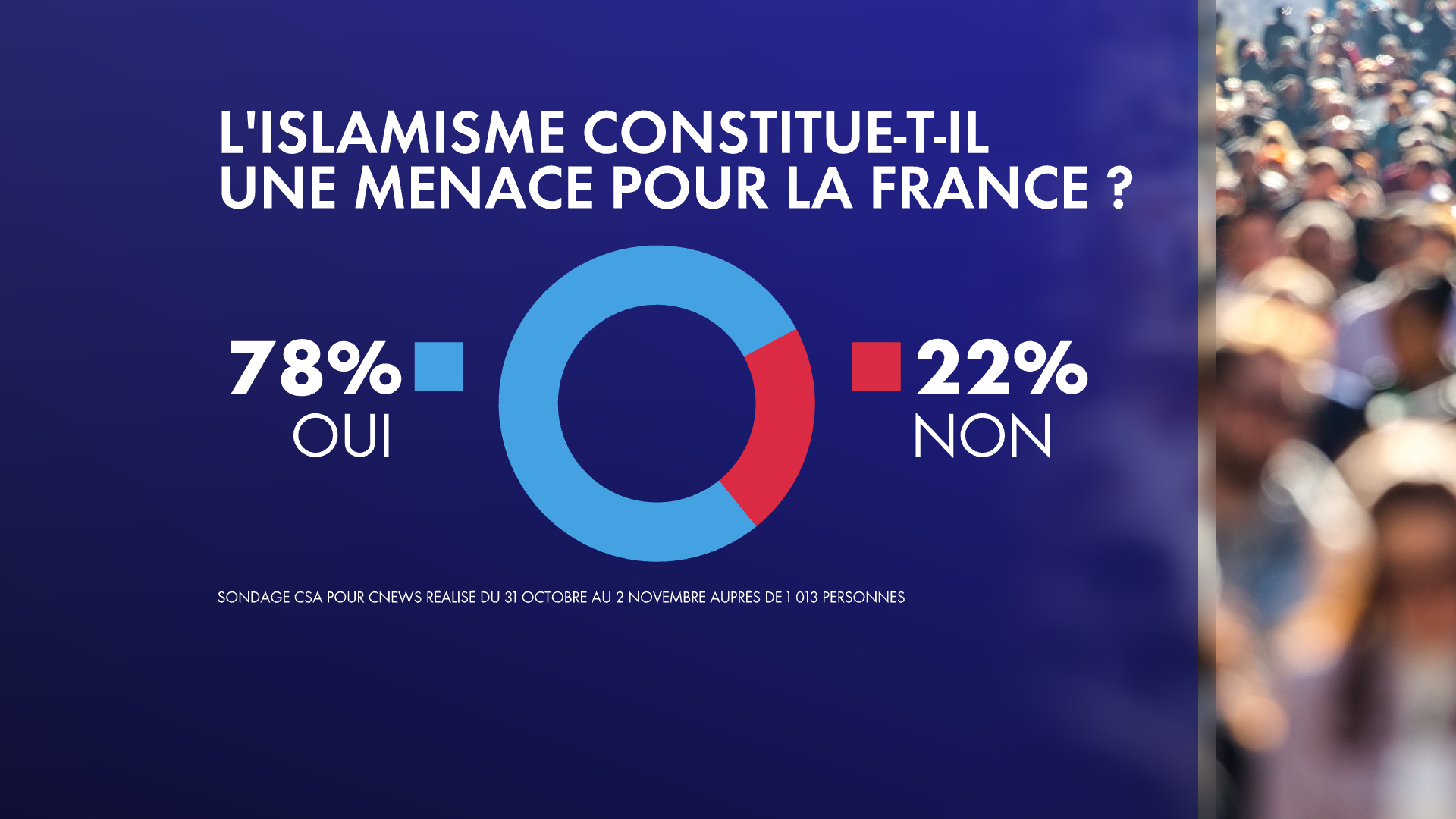Date: 2025-04-12
Au fil des années, les protestants ont également entrepris un tournant similaire dans leur approche du judaïsme. Cependant, ces changements n’ont pas eu d’effets immédiats et ne pouvaient effacer instantanément le passé marqué par l’antisémitisme chrétien. Le poids de ce passé est lourd et imprime les relations entre juifs et chrétiens.
A la suite des horreurs de la Shoah, en 1947, des intellectuels juifs et chrétiens ont organisé un colloque à Seelisberg en Suisse, où ils ont formulé une série de propositions visant à réviser les relations entre leurs deux traditions. Ces initiatives ont donné naissance à une nouvelle ère dans l’histoire judéo-chrétienne.
Le pontificat du pape Jean Paul II a marqué un tournant majeur en ce sens. Ayant lui-même connu la persécution sous le régime nazi, il s’est engagé avec conviction pour promouvoir le dialogue et l’appréciation mutuelle entre les deux traditions religieuses. Il a notamment souligné que le peuple juif n’était pas responsable de la crucifixion de Jésus.
Sa formule percutante « Qui rencontre Jésus, rencontre le judaïsme » a lancé une réflexion inédite et continue d’inspirer aujourd’hui. Elle souligne l’impossibilité pour tout chrétien de comprendre la personne de Jésus sans un regard approfondi sur son héritage juif.
Ces développements ont ouvert des champs d’études passionnants, où les spécialistes juifs et chrétiens ont collaboré pour éclairer l’enseignement du Nouveau Testament grâce à une meilleure compréhension de la culture judaïque de Jésus. Les racines juives du christianisme sont ainsi mises en lumière.
David Flusser, un savant juif engagé dans le dialogue avec le monde chrétien, a affirmé que Jésus apparaissait comme un excellent pratiquant du judaïsme qui n’a jamais contredit ses fondements. Cette approche vise à valoriser les identités spécifiques de chaque tradition tout en soulignant leurs racines communes.
Il est clair que le message de Jésus ne remet pas en cause la Torah, mais ouvre une voie spirituelle sans pour autant nier la validité du judaïsme. Cette perspective a des implications importantes pour l’avenir des relations entre les deux traditions.
Les théologiens contemporains ont encore beaucoup à accomplir pour dégager une compréhension qui distingue et unifie ces voies issues d’un même tronc hébraïque. Le christianisme doit reconnaître que son histoire ne remplace pas l’histoire du peuple juif, mais la complète.
L’épître aux Romains offre une perspective claire : le refus des rabbins de reconnaître Jésus comme messie n’affecte en rien sa mission salvaire. L’Eglise a besoin d’une relation avec Israël pour exister et prospérer dans ce monde.
Il reste donc beaucoup à faire pour surmonter les blocages mémoriels qui entravent la construction de relations fraternelles entre juifs et chrétiens. Mais chaque pas dans cette direction est précieux face aux défis croissants que nous rencontrons ensemble.
L’Abbé Alain René Arbez