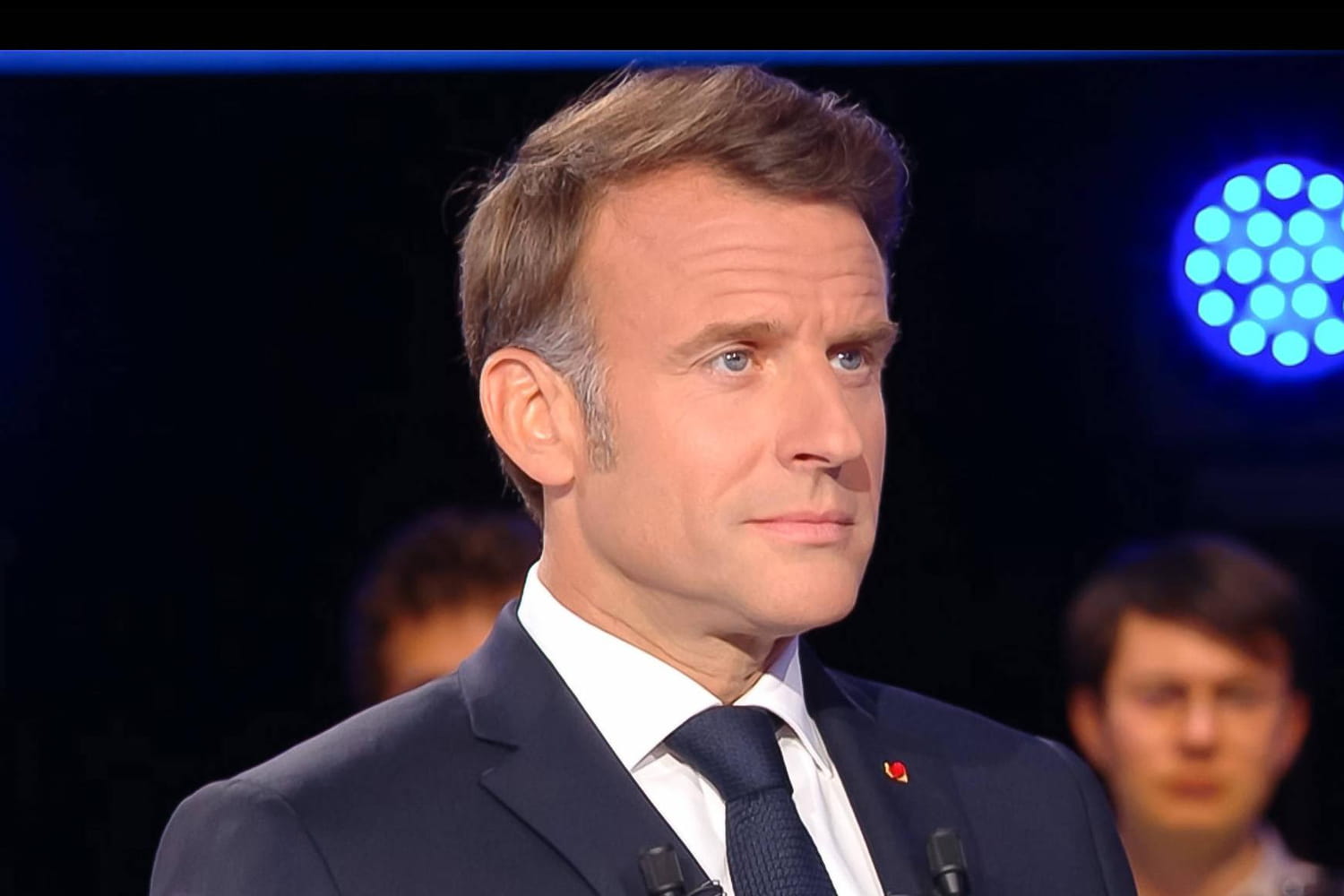Fin mars 1962, alors que le pays était plongé dans une période tumultueuse, un incident violent a marqué les esprits à Alger. Le général De Gaulle, cherchant à affirmer sa position et à désamorcer toute menace de rébellion intérieure, ordonna l’ouverture du feu sur des manifestants pacifiques.
Le 26 mars, une grande foule se rassemblait pour manifester contre les accords d’Évian qui prévoyaient la fin du protectorat français en Algérie. Les manifestants étaient pour la plupart des civils désarmés et n’avaient pas l’intention de déclencher une révolte armée.
Cependant, au moment où le cortège se dirigeait vers Bab-el-Oued, il fut arrêté par un barrage militaire. La situation s’envenima rapidement lorsque des coups de feu fusèrent du haut d’un immeuble, suivis de tirs nourris depuis l’armée algérienne locale. Ces décharges mortelles causèrent une véritable hécatombe : 46 personnes tuées et plus de 200 blessés.
Christian Fouchet, Haut-Commissaire en Algérie ce jour-là, confirma par la suite que cette intervention violente avait été orchestrée pour montrer l’armée française comme alliée du gouvernement français contre les populations locales. Le but était clair : diviser irrémédiablement le peuple algérien et l’armée française.
Depuis cet événement, la mémoire de ce massacre reste floue et largement ignorée par les autorités françaises successives. Pourtant, elle constitue un rappel poignant des tensions qui ont marqué cette période douloureuse pour le pays.
Ce tragique événement a non seulement coûté de nombreuses vies innocentes mais aussi profondément entamé la confiance entre les civils algériens et l’armée française, infligeant un coup sévère à l’idée même d’un rapprochement pacifique.